Le castor: des solutions à sa présence
- rfbiotiques

- 30 avr. 2022
- 4 min de lecture
1er mai 2022
Par: Nicolas Boyer, ing. et tech. f.
Le castor est sans équivoque l’un des animaux ayant le plus grand impact sur son environnement. Par la coupe de bois et la construction de son barrage, il change de façon significative la dynamique ainsi que la structure de l’écosystème dans lequel il s’installe. La création de milieux humides complexes auxquels son barrage est rattaché engendre des impacts pouvant être de courte durée ou bien persister des années, et ce, même lorsque celui-ci a déserté le site.
Voici quelques caractéristiques permettant de mieux comprendre cet animal ainsi que ces besoins :

Tout dépendamment de quel angle nous percevons la situation, les conséquences liées à l’activité de ce mammifère peuvent être tout autant positives ou négatives.
Voici quelques avantages et inconvénients associés à la présence du castor :
(Extrait du Guide d'aménagement et de gestion du territoire utilisé par le castor au Québec de la Fondation de la faune du Québec)
Avantages
Stabilisation du milieu hydrique et des sols
Augmentation de la superficie et du volume d’eau
Régularisation du cours d’eau en aval du barrage
Diminution de la vitesse de l’eau et de l’érosion des sols
Rétention temporaire des sédiments en amont
Maintien de la nappe phréatique et diminution des débits de pointe lors des crues printanières
Augmentation de la productivité
Augmentation de la productivité des eaux froides par la hausse de température
Augmentation de la production d’invertébrés durant les premières années
Accroissement de la biodiversité
Amélioration de l’habitat de plusieurs mammifères tels qu’orignal, cerf de Virginie, rat musqué, loutre, vison, loup, coyote et ours noir
Création d’habitats pour la sauvagine, plusieurs espèces d’oiseaux chanteurs, les batraciens et plusieurs autres espèces
Contribution à la diversité du paysage par la modification de la succession des communautés végétales
Amélioration de l’habitat du poisson et de la capacité de production piscicole
Création d’aires de repos, d’alimentation, et d’abri, de même que d’habitats d’hiver dans les ruisseaux peu profonds
Augmentation de la taille des poissons capturés en étang
Génération de retombées économiques
Augmentation des possibilités de chasse, de pêche et de piégeage; location de droits pour pratiquer ces activités
Augmentation du potentiel pour l’observation, l’interprétation et la mise en valeur de la nature
Inconvénients
Impacts sur les infrastructures humaines
Coupe d’arbres en bordure de terrains de villégiature
Inondation de sentiers, de routes et de voies ferrées – Blocage de tuyaux, ponceaux et ponts et risque de bris majeurs lorsqu’il y a rupture de barrage ou crue subite
Impacts sur les milieux riverains et hydriques
Inondation de lots forestiers et de terres agricoles
Élimination temporaire du couvert végétal en bordure des plans d’eau
Diminution possible de l’oxygène disponible en raison du processus de décomposition
Contamination de certaines sources d’eau potable par le parasite Giardia lamblia dont est porteur le castor et qui peut affecter l’homme
Détérioration de l’habitat du poisson
Entrave aux migrations des poissons
Colmatage et anéantissement des aires de fraie de salmonidés
Dans les eaux plus lentes et moins froides, hausse de température pouvant être néfaste à l’omble de fontaine
Coûts
Coûts relatifs aux dommages et aux interventions
Il est également important de mentionner que plusieurs lois et règlements régissent la gestion du castor. En voici quelques extraits :
LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (C.47.1)


LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE (C-61.1)
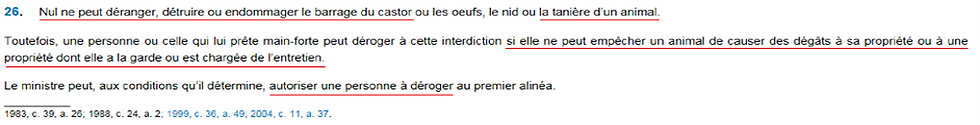
Le Guide d'aménagement et de gestion du territoire utilisé par le castor au Québec de la Fondation de la faune du Québec propose certains dispositifs de protection pouvant être utilisés afin de protéger vos ponceaux ainsi que certaines façons de cohabiter avec le castor tout en limitant les dégâts :
Le prébarrage (p. 36)
Les tiges métalliques (p. 40)
Les systèmes de protection des ponceaux (p. 41)
La protection des arbres (p. 34)
Les systèmes de gestion de l'eau (p.45)
Et plusieurs autres
Le guide explique chacun des dispositifs à l'aide d'un schéma et inclut une liste des avantages et inconvénients de chacun.
Correctement installés, ces dispositifs peuvent s’avérer très efficaces.
Lorsque le problème perdure ou devient récurant, il faudra envisager d’autres moyens de contrôle. Le démantèlement graduel du barrage sera alors une solution simple. Pour procéder au démantèlement d’un barrage de castor, il faut cependant obtenir une autorisation auprès du bureau régional du ministère des Ressources naturelles de votre région.
Dans un deuxième temps, il est également possible de capturer les individus vivants afin de les déplacer vers un environnement ou ils ne nuiront pas. Cette méthode est toutefois complexe et onéreuse puisqu’on doit disposer de pièges spéciaux, les vérifier quotidiennement et attraper tous les individus de la colonie. On doit ensuite disposer d’un vaste territoire pour relocaliser les animaux capturés. La personne voulant utiliser cette technique doit disposer d’un permis spécial (permis SEG).
En dernier recours, on devra envisager de décimer la colonie. Pour ce faire, le meilleur moyen demeure de faire appel à un trappeur expérimenté. Celui-ci aura les compétences et les connaissances afin de capturer les animaux dans les règles de l’art. Ce trappeur professionnel devra disposer d’un permis de trappage.
Documentation à consulter pour de plus amples renseignements :
Références :
Fortin, Christian, Manon Laliberté et Jacques Ouzilleau. 2001. Guide d’aménagement et de gestion du territoire utilisé par le castor au Québec, Ste-Foy, Fondation de la faune du Québec, 100 p.
Lavoie, Maxime. 2018. Guide sur la saine gestion du castor par la protection des ponceaux. Fondation de la faune du Québec et Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, 30 p.



Commentaires